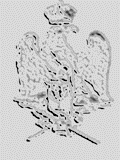1815 : France.
1er Mars : Napoléon débarque à Golfe Juan avec 2 000 hommes. L’effectif est insignifiant pour lutter contre l’Armée catholique et royale. Et la troupe se réduit encore avec 50 hommes qui sont faits prisonniers à Antibes. Un bataillon du 5e Régiment d'infanterie de ligne se rallie, voilà l’effectif quasiment doublé. La troupe est composée désormais d’un tiers de soldats et de deux tiers de paysans ou de villageois souvent vétérans des campagnes de la Révolution ou de l'Empire. Grasse, Castellane et Digne sont traversés sans encombre. Devant Grenoble, le 7e de ligne se rallie, puis les 20e de ligne, le 24e de ligne et le 24e Dragons. A Lyon c’est le délire. Le “Vol de l’Aigle” se poursuit et à chaque ville la garnison se rallie et la population chasse les fonctionnaires royaux. 6 000 hommes de plus se rallient à Lons-le-Saunier. Le Roi et sa cour gagnent la Belgique. Napoléon rentre à Paris. Il n’a plus vraiment l’intention de faire la guerre, mais l’Angleterre, les Pays Bas et la Prusse n’ont pas l’intention de laisser revenir « l’Ogre » avec ses idées venues de la Révolution. Une nouvelle coalition, la septième, se prépare. Les événements vont dès lors se succéder .
1815 : Vendée.
Soulèvement en Vendée, le 15 mai, le 26e de ligne doit battre en retraite devant les forces vendéennes. Les Anglais débarquent le 1er juin. Les troupes françaises battent les royalistes aux Marthes. La population n’a pas basculé et a fait feu sur les Chouans. Le 20 mai, les troupes vendéennes sont défaites à Aizenay. Un armistice est signé le 26 juin.
30 mars 1815 : France
L’Empereur rappelle sous les drapeaux tous les militaires en congé. Dans le midi, les Royalistes parviennent à constituer une petite armée de 12 000 hommes qui marchent vers Lyon. Les troupes impériales et les gardes nationaux marchent à sa rencontre. Les deux principaux régiments de ligne qui s’étaient soulevés repassent dans le camp de Napoléon. La révolte est terminée le 8 avril.
Le 30 mai, les conscrits de la classe 1815 sont appelés.
12 juin 1815 : France, Belgique.
Les Coalisés s’approchent des frontières, ils sont un million. Les soldats français repartent en campagne. L’Empereur rassemble 559 000 hommes, vétérans, Marie-Louise, réformés et invalides qu’il répartit en 217 000 hommes dans la Ligne, 146 000 hommes dans les dépôts, 196 000 hommes de garde dans les places fortes, les côtes et les ports. Si les forces françaises sont encore importantes et des victoires ont été obtenues avec un désavantage numérique équivalent, il en va tout autrement du commandement. Beaucoup de maréchaux et de généraux sont restés chez eux et l’armée est préparée à la hâte. L’artillerie qui a gagné tant de bataille n’est pas au complet. Le Génie est inexistant. Les autorités recourent à des moyens de fortune pour équiper la Ligne et le temps manque. Seuls les stocks de munitions sont conséquents. Un climat de méfiance règne dans l’armée. Les dénonciations, les avertissements, les réclamations pleuvent. Le soldat-citoyen se méfie des officiers qui après avoir rallié la Royauté quelques semaines plus tôt sont revenus faire soumission à l'Empereur. Aux 25e de ligne et au 39e de ligne ainsi qu'au 12e Dragons les hommes demandent la destitution de leur colonel. Un grognard ose même le demander de vive voix à l’Empereur.
Napoléon avec 155 000 hommes marche vers la frontière belge. Répartis en 5 corps d’armée, l’Armée du Nord marche par Laon, Maubeuge, Avesnes, Chimay, Rocroi. Suivent : la Garde Impériale et 4 corps de réserve de cavalerie. Environ 89 000 fantassins, 24 000 cavaliers, 12 000 artilleurs, soldats du Train et du Génie partent pour la guerre. Un corps d’armée, c’est une colonne de 7 kilomètres et demie qui se déplace. Il faut 3 heures pour qu’elle s’écoule. Le 14 juin, la concentration des troupes françaises est accomplie à quelques kilomètres de la frontière. Le but de l’Empereur est de battre les coalisés les uns après les autres. Pour l’heure sus aux Prussiens. Le 15 juin à partir de 02H30, l‘Armée du Nord amorce sa marche en avant, taillant en pièces les avant-gardes prussiennes. Au petit-jour, une nouvelle va faire hurler les soldats, le gl de Bourmont, comte de Gaisne, et son état-major passent à l’ennemi. Les soldats avaient donc raison de se méfier des nobles d‘Empire ! Au soir, les Français établissent leur campement en grommelant. Napoléon sépare ses forces en deux ailes et une réserve qui reprennent leurs marches le 16 juin. La matinée se passe dans une pagaille totale. Les ordres de Napoléon sont incomplets, contredisent parfois ceux du major-général de la Grande Armée (général Jean de Dieu Soult), n’arrivent pas ou arrivent avec du retard. Le contre-ordre arrive avant l‘ordre, les courriers se perdent en route.
L’aile droite sous le commandement du gl Grouchy rencontre les Prussiens à Ligny. Dans le village, on s’étripe à la baïonnette, à coup de crosse sous le feu des canons. Le combat est d’une férocité rarement atteinte. Un orage se déclare et c’est sous une pluie battante que les combats se poursuivent. On se bat jusque dans le lit de la rivière. On se massacre dans les maisons, se poursuivant de pièces en pièces. Les Français y perdent 8 500 morts et blessés, les Prussiens perdent 23 000 hommes dont 10 000 jeunes soldats qui désertent (Blücher en récupérera une bonne partie). Le gros des Prussiens se dérobe et bat en retraite.
L’aile gauche sous le commandement du maréchal Ney rencontre les anglo-hollandais aux carrefour des Quatre-Bras. Les Français attaquent au son du tambour en chantant le Chant du Départ (rappelons que la Marseillaise n'est plus l'hymne national). De charges de cavalerie en assauts à la baïonnette, les Français sont contenus. Au soir, ils ont perdus 4 200 tués et blessés. Ils bivouaquent, sans feu, en formation en carré, sous les armes. Les Anglo-Hollandais battent en retraite.
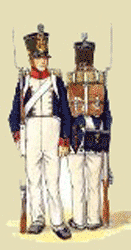
17 juin 1815 : Belgique.
L’aile droite est à la poursuite des Prussiens et Napoléon a rejoint l’aile gauche. La bataille reprend. Sous une pluie battante la cavalerie française poursuit les Anglais en pleine retraite. Retraite organisée car de place en place des unités ont pris position pour protéger les fuyards. La cavalerie française est mise à mal et subit des pertes sérieuses. Les ordres parviennent toujours aussi mal aux unités. Des régiments errent dans la campagne ne sachant où aller. Les hommes sont épuisés, à cours de vivres. A la nuit, des régiments cherchent leur chemin à la lueur des torches. Dans les villages, c‘est un désordre sans nom. Des soldats maraudent à la recherche de nourriture, les corvées cherchent en vain le ravitaillement. Les hommes bivouaquent au hasard sous la pluie continuelle qui empêche de faire du feu. Ils se serrent par petits groupes pour se réchauffer, dorment parfois debout ne pouvant s’allonger dans le bourbier.
18 juin 1815, le terrain est détrempé, Napoléon attend. Les 59 000 fantassins et les 15 000 cavaliers français appuyés par 344 canons ont campé sous la pluie. C'est la deuxième nuit où ils ont tenté de dormir debout. Ils sont trempés, épuisés et attendent le soleil. Ils espèrent en l’arrivée des unités qui sont toujours en route et qui arrivés sur le futur champ de bataille seront épuisées. Ils nettoient leurs armes, recherchent toujours de la nourriture. Les ordres sont de faire la soupe mais avec quoi ? Les troupes engagées aux Quatre-bras n'ont pas mangé depuis 2 jours.

En face, les Britanniques, les Belges, les Hollandais commandés par Wellington ne sont pas mieux lotis. Mais ils ont choisi leur terrain et ils sont ravitaillés. Devant le village de Waterloo, sur le plateau de Mont Saint Jean, ils sont 70 000 qui attendent.
A partir de 11H35, l‘assaut est donné à partir de la gauche française. La bataille de Waterloo vient de commencer. Les Français s’avancent en lignes continues sur plusieurs rangs. Hougoumont, La Haye-Sainte, Papelotte, la Belle-Alliance, Plancenoit, vont entrer dans l’histoire. A 13H30, l’artillerie commence son tir de barrage. Au son des tambours et des fanfares de régiments, drapeaux déployés, les fantassins français chantent à pleine voix le "Chant du départ" et s’élancent sur un front de 1 800 mètres. La cavalerie anglaise charge, sabre les fantassins, dépasse les premières lignes, s’en prend aux canonniers en plein déplacement, aux conducteurs, aux sapeurs, avant de finir hachée par la réserve française. A 16H00, un malentendu entraîne l’assaut de Ney avec 5 000 cavaliers. Les Anglais disposés en carrés, repoussent l’assaut. A 17H00, un second assaut encore avec 9 000 cavaliers. La terre tremble sous les pas des chevaux de 70 escadrons qui chargent sur un kilomètre de front. C’est un nouvel échec. D’autres charges se succèdent sans plus de succès. Il y aura six charges de cavalerie. Les survivants se font de moins en moins nombreux. Il n’y a plus de cavaliers pour un septième assaut. Les renforts attendus par Napoléon n’arrivent toujours pas. La ferme de la Haye-Sainte contre laquelle les Français s’acharnent, tombe enfin au troisième assaut.

Les carrés
de Waterloo, Reconstitution
Les Prussiens qui ont distancés Grouchy toujours à leur recherche arrivent sur le champ de bataille. Ils viennent de parcourir 14 kilomètres. Le VI° corps français (7 000 hommes) les attaque en vain. Les Prussiens se renforcent de minute en minute, ils sont 29 000 à 17H30.
Vers 19H00, Napoléon fait donner les 8 bataillons de la Jeune Garde, puis 2 bataillons de grenadiers de la Vieille Garde et 2 bataillons de Chasseurs de la Garde. C’est extrêmement rare. Chasseurs, Voltigeurs, Tirailleurs, Grenadiers se font massacrer. Napoléon lance alors 7 bataillons de la Vieille Garde, ses ultimes réserves. Les « Immortels » s’avancent de leur pas lent, dans la nuit qui commence à tomber. Pas un murmure dans la troupe. Les Anglais canonnent à bout portant. Les colonnes de la Vieille Garde succombent sous la mitraille et commencent à reculer en bon ordre. C’est la première fois depuis 15 ans. A la vue de ce recul, c’est une panique injustifiée, un cri retentit " la Garde recule" . De proches en proches, les unités se débandent.
Wellington lance à l’attaque ses dernières troupes. Descendant du Mont-Saint-Jean, les troupes anglaises, hollandaises et prussiennes attaquent les colonnes françaises. La Garde forme les carrés, massacrés par l’artillerie anglaise. Un dernier carré se forme avec le 2e bataillon du 3e Régiment de Grenadiers de la Garde. Ce qui permet à beaucoup d’hommes de s’enfuir vers Charleroi. Ce dernier carré de 550 hommes sur lequel s’acharne toute l’artillerie anglaise refuse de se rendre. La cavalerie anglaise charge en vain. Les 150 derniers grognards ont épuisés leurs munitions. Ils chargent à la baïonnette et tombent tous sous la mitraille. Ils ont tenus le serment : “La garde meurt mais ne se rend pas”. Le gl Cambronne a-t'il prononcé le mot qui deviendra célèbre, on ne le saura jamais ? A 23H00, des coups de feu retentissent encore.
Au matin du 19 juin, les Anglais, les Belges, les Hollandais et les Prussiens réunis relèvent 45 000 tués et blessés français, hollandais, belges, anglais et prussiens dans un carré de 2 kilomètres sur 2. Ajoutons- y 15 000 cadavres de chevaux. En certains endroits, c’est un véritable mur de cadavres de ce que furent les carrés de Waterloo. Dans un chemin creux, tout un escadron de carabiniers a été fauché. Des blessés tentent de s‘échapper du tas de cadavres. Plus loin, c‘est un escadron de cuirassiers qui gît dans leurs cuirasses noircies. Les pillards fouillent cet amas de corps. Le 21 juin, les villageois réquisitionnés rassemblent les cadavres. Ils trouvent encore des blessés vivants. Ces mêmes villageois mettront 10 jours à brûler les cadavres, toutes nations confondues. Il n’y a pas de cimetière à Waterloo.
L’armée Grouchy a rattrapé enfin les Prussiens le 18 juin. Ceux que l’on pensait en fuite sont bien installés entre l’armée Grouchy et l’armée Napoléon. De violents combats se déroulent. Au matin du 19 juin, la nouvelle de leur victoire à Waterloo parvient au gros des Prussiens qui passent à l’offensive. Grouchy lui est sans ordre clair et décide de battre en retraite vers la frontière. Cette retraite va se dérouler en bon ordre. Les Français décrochent par échelons contenant les Prussiens malgré de lourdes pertes. Ravitaillés par les villageois belges, les colonnes françaises atteignent Namur où l‘accueil de la population est admirable. Les Belges soignent les blessés, ouvrent leurs caves, offrent vivres, vin et pansements à cette armée en retraite. La retraite continue vers Dinant. Les Prussiens renoncent devant Namur auquel ils ont donné sans succès l’assaut. L’armée Grouchy passe la frontière française le 21 juin. 28 000 hommes valides et 1 000 blessés sont sauvés, ils ramènent 100 canons. La marche continue vers Soissons où s’opère le rassemblement. Napoléon est rentré à Paris. Le 22 juin, il abdique.
Le million de coalisés attend de déferler sur la France. Les troupes à leur opposer et disponibles sont encore importantes. L’Armée du Nord, sous le commandement de Grouchy, s’est reconstituée entre Laon, Reims et Soissons et marche vers Paris avec 50 000 hommes, poursuivis par les Prussiens. Des combats d’arrière-garde ralentissent l’avance de l’ennemi. Les désertions sont importantes, mais elles cessent dès que les troupes françaises sont au contact de l’ennemi. Wellington et les Anglo-hollandais se sont arrêtés à Cambrai puis repartent. Les garnisons du Nord qui voient défiler devant leurs yeux stupéfaits les fuyards et les rescapés de Waterloo résistent aux Coalisés qui pénètrent en France. Les Autrichiens, les Bavarois, les Wurtembergeois, les Russes, les Piémontais se joignent aux vainqueurs de Waterloo. Les villes de Strasbourg, Lunéville, Chateau-Salins, Nancy tombent. Les Espagnols pénètrent en Roussillon, une flotte anglaise croise devant Toulon. L’Armée des Alpes résiste à grand peine aux Piémontais et aux Autrichiens. L’Europe entière déferle sur la France.
L’Armée du Nord s’est positionnée à Paris. Le gl Davout, qui remplace Grouchy démissionnaire, dispose de 75 000 soldats de la ligne et de la Garde, de milliers de gardes nationaux, fédérés, volontaires et vétérans, en tout de 100 000 à 117 000 hommes et de 600 canons. Blücher attaque le 30 juin, les Prussiens sont repoussés avec de lourdes pertes. Lorsque les Français opèrent une sortie, l’ennemi est repoussé. Les combats se déroulent à Aubervilliers, Gonesse, à Neuilly, à Sèvres, à Vaugirard, à Versailles, à Rocquencourt. Au Chesnay, les habitants font le coup de feu aux côtés des soldats. Paris serait-il imprenable ?
Les politiques français demandent néanmoins l’armistice accepté par les Coalisés. Les termes de ce traité prévoit l’évacuation de Paris par l’Armée du Nord. Les 5 et 6 juillet, la rage au cœur, les troupes françaises évacuent Paris et marchent vers la Loire.
Le 8 juillet, Louis XVIII revient à Paris. Cette fois, l’Empire est bien terminé. L’Empereur après bien des hésitations se rend aux Anglais qui l’envoie en exil à Saint Hélène où il mourra en 1821.
A Maubeuge, la garnison résiste et ne se rend que le 14 juillet après un siège de 24 jours. Landrecies et Soissons résistent jusqu’au 20 juillet. A Rocroi, 600 soldats, 100 bourgeois et 60 douaniers, s’enferment et résistent jusqu’au 15 août face à 6 000 Prussiens.
A Laon, la troupe exaspérée refuse que les autorités arborent le drapeau blanc de la royauté. 2 600 soldats et 800 gardes nationaux résistent aux Prussiens qui cernent la ville. Devant les lettres menaçantes venues de Paris, la garnison, tambour en tète, sort de la ville avec ses canons. Partis de Laon le 10 août, ces rescapés arrivent à Orléans en bon ordre le 19 août, deux mois après Waterloo. Les places fortes continuent à se battre, en manifestant leur hostilité aux Bourbons. A Rethel, les soldats rassemblés par le nouveau Ministre de la Guerre crient “Vive l’Empereur”. Montmédy sera l’une des dernières places fortes à se rendre, le 30 septembre soit 3 mois après Waterloo. Les francs-tireurs que nous avions vu à l’œuvre en 1814 continuent leur combat.
Pendant que les places fortes résistent, les rescapés de l’Armée du Nord que nous avons vu sortir de Paris, doivent se retirer au sud de la Loire. Ils le font lentement, la colère au cœur. Le 11 juillet, 100 000 hommes ont passé la Loire, sans chef, sans solde, sans ravitaillement. Devant faire acte de soumission au roi, le 15 août, l’armée ne compte plus que 55 000 hommes. Les autres sont rentrés chez eux.
Les Coalisés s’installent dans 7 départements français avec 150 000 hommes qui pillent, rançonnent sans pitié. L’ occupation ne cessera que fin 1818. L’armée prussienne terrorise la population. Plusieurs générations de Français seront imprégnées de cette terreur.

L'Infanterie de ligne
Les guerres de la Révolution et de l’Empire auraient coûté à la France 850 000 tués, 550 000 présumés disparus et 150 000 morts naturelles sur 2 800 000 soldats (dont 2 100 000 appelés).
Ces chiffres sont sujet à discussion, les effectifs de la Grande Armée sont eux mêmes très confus. La Grande Armée au temps de sa toute puissance comportait de forts contingents étrangers, aux effectifs inconnus et changeants.
![]()
L’économie est ruinée. De première puissance en Europe, la France passe au second plan et ne s’en remettra jamais. Elle a perdu toutes ces colonies, sauf quelques îles aux Antilles, Saint Pierre et Miquelon, les 5 comptoirs de l’Inde et passe ainsi derrière l’Angleterre, l’Espagne, le Portugal. Napoléon s’est désintéressé des colonies et toutes ont été perdues au cours de son règne. La Louisiane a été vendue aux États-unis. Les territoires qui sont rendus à la France, c’est uniquement par le bon vouloir des Anglais.
Le territoire français est ramené aux frontières de 1789, et la France perd d’un coup plus de 500 000 habitants. Pourtant fin 1815, la population française a progressé de 28 millions en 1789 à 30,3 millions.
![]()
La Garde : Quelques mots sur ces vétérans, issus de la conscription, et qui sont devenus des professionnels de la guerre, après tant et tant de campagnes. La plupart ne connaissent rien d’autre que l’armée. Ils font partie de ce corps d’élite, la Garde, troupe préférée de l’Empereur, pour laquelle il a toutes les indulgences. Il accepte d’eux des remarques qu’il n’accepterait pas de ses généraux. Ne les appelle-t-il pas les Grognards, ne l’appellent-ils pas le Petit Tondu ou le Petit Caporal. Ce sont les Grenadiers qui assurent la protection des campements et des lieux de séjour de l'Empereur. Mieux nourris, mieux vêtus, mieux soignés que le reste de l’Armée, ils se font tuer pour lui. Recrutés après quelques années dans la Ligne, sur des critères physiques mais surtout de courage, ils sont d’abord versés dans la Jeune Garde (la jeune Garde sera amenée en 1814 à recruter directement des conscrits) puis passent dans la Moyenne Garde et ce ne sont que des années plus tard, sauf circonstances exceptionnelles, qu’ils sont versés dans la Vieille Garde. L’image nous montre un Grenadier de la Vieille Garde, mais il existe également des Chasseurs de la Garde, des Marins de la Garde, des Artilleurs de la Garde. C'est une armée dans l’Armée.
Les grenadiers de Vieille Garde jusqu'en 1814 n’interviennent pratiquement jamais, leur seule présence à l’arrière de l’Infanterie de Ligne est une menace constante pour l’ennemi. Les troupes de ligne qui les jalousent les surnomment "les immortels" car ils ne combattent pratiquement pas. Ils vont mourir à Waterloo.

L’élite
![]()
La Marine : Après Trafalgar, Napoléon se désintéresse de la marine qui n’a pas été capable d’obtenir la maîtrise de la mer pour lui permettre de débarquer en Angleterre. Mais dès 1807, Napoléon entreprend de reconstituer sa marine. Il va se heurter à un problème majeur, le manque d'équipages confirmés. Le recrutement s'effectue toujours difficilement. L'Inscription maritime ne donne pas les résultats escomptés. Même un marin à la pêche ne fait pas obligatoirement un bon marin de vaisseau de guerre. Alors on engage des indigents, des miséreux ramassés sur les quais, même des enfants trouvés venant des hospices. Si ça ne suffit pas des soldats embarquent. Napoléon a décrété que tous les marins doivent être aussi des soldats et beaucoup de temps est consacré à l'entraînement du soldat d'infanterie. En 1808, Napoléon décide de transformer les équipages en bataillons de marine. Un bataillon de 700 ou 900 hommes par vaisseau, un bataillon pour deux frégates. Les marins reçoivent les mêmes uniformes que les soldats. Les vrais marins qui sont si fiers de leurs différences ne le supportent pas. Jamais Napoléon ne recevra la dévotion à sa personne que les soldats lui témoignent. L'entraînement est réduit à des ronds dans l'eau dans les rades. Tout est sacrifié à la navigation, peu d'exercices de tir. Mais même la navigation pose problème. Chaque sortie en haute mer pose problèmes.
La marine n’est jamais en mesure de rivaliser avec la marine anglaise et ne peut pas empêcher le transport sur le continent des troupes britanniques qui pèseront si lourd lors de Waterloo ? Ni ne peut empêcher l’acheminement vers les pays lointains de troupes qui enlèvent à la France toutes ses colonies. Pourtant, il sera construit de nombreux navires : 83 vaisseaux de ligne de 1801 à 1814 .
A la fin de l’Empire, sur les 100 000 à 120 000 marins français prisonniers en Angleterre, 80 000 ont disparus, morts de faim, de froid, de consomption, morts de manque d’espace pour se mouvoir, morts faute d’air pour respirer.
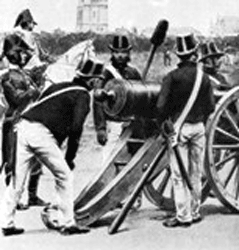
Marins-artilleurs
Les Anglais ont saisi 31 vaisseaux de ligne. Il reste à la France 71 vaisseaux construits à la hâte en bois fraîchement coupés. Ils ne seront plus que 31 en 1819 avec des équipages et un commandement décimés par une nouvelle épuration. Les officiers nommés par la Révolution ou l’Empire sont destitués et mis en retraite avec demi-solde, contrairement à l’ armée de terre où certains des officiers de haut rang continueront à servir le Roi comme ils ont servi l’Empereur.
Le Roi et les nobles émigrés qui reviennent au pouvoir en 1815 n’ont rien compris au séisme qui a ébranlé l’Europe ces 30 dernières années. Ils nomment de nouveau au commandement des navires et des escadres, des nobles qui n’ont pas mis les pieds sur une dunette depuis bien des années, qui ne connaissent plus rien à la mer (s’ils y connaissaient quelque chose, ce qui n’est pas la majorité d’entre eux). Les équipages ne sont pas motivés après tant d’années de mer et tant de désastres maritimes.
Pourtant, la marine va être rapidement mise à contribution.