LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE
"J'ai cru longtemps que la guerre était une aventure exaltante. Je sais maintenant que c'est l'horreur absolue" Winston Churchill.
25 août 1939, les classes les plus récemment libérées sont rappelées. Le 1er septembre, l'Armée allemande entre en Pologne. La France, mobilise ses réservistes et les affiches apparaissent sur les murs de toutes les communes de France. La date de mobilisation générale est le samedi 2 septembre 1939. Tous les hommes valides de 20 a 48 ans sont mobilisés. Mais, les moyens de transport existants ne peuvent permettre de les déplacer tous en même temps aussi, à l'issue de leur service militaire (qui a l'époque dure 2 ans) sont-ils tous munis d'une brochure (un fascicule, c'est le terme employé par l’autorité militaire) où sont mentionnés, en cas de mobilisation générale (jour J) le jour où ils doivent se mettre en route et le régiment qu'ils doivent rejoindre. Ces dates varient du jour J pour les plus jeunes qui viennent juste de terminer leur service militaire, jusqu'à J+8 pour les plus âgés.
Le dimanche 3 septembre à 11 heures pour la Grande Bretagne et à 17 heures pour la France, la guerre est déclarée à l'Allemagne. Pour la France, les hostilités commencent immédiatement.
La liesse populaire est beaucoup moins grande qu'en août 1914. Les hécatombes de 1914-1918 sont encore très présentes dans les esprits. 500 000 survivants de 1918 sont, de nouveau, requis pour cette nouvelle épreuve. Ils sont très nombreux dans les sous-officiers et officiers de réserve. Père, fils et frères partent parfois ensemble. 29 classes d'âge sont rappelées dont les classes 1909 à 1917 ayant participé à la Grande Guerre. Pour tous, anonymes et célébrités en vogue, direction le centre de regroupement. Des réfugiés sont incorporés dans l'armée comme ces 12 000 volontaires étrangers regroupés au sein de Régiments de Marche de Volontaires Étrangers. L'enthousiasme n'est pas de mise, mais les autorités ne comptabilisent que 3 700 déserteurs et insoumis et encore certains d'entre eux avec un motif valable. La résignation est totale, et c'est la troisième mobilisation en quelques mois. La première fraction de la classe 1939 est appelée. Les ajournés des classes précédentes repassent le Conseil de Révision. La mobilisation touche aussi les officiers en réserve et même en retraite. Weygand (72 ans) est l'un de ces généraux en retraite (depuis 1935) rappelé au service.
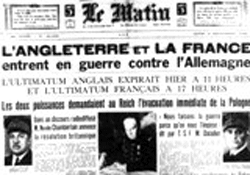
5 millions de Français sont mobilisés, I/4 de la population masculine. En réalité, seulement 1 500 000 hommes sont immédiatement disponibles. 700 000 sont dispersés en Afrique du Nord, au Levant ou dans les autres colonies. Les autres doivent être remis à l'entraînement.
L’impréparation est totale. Certains hommes ne reçoivent pas de chaussures, d'autres pas de chaussettes. Il manque des bretelles pour les fusils. Les stocks de fusils sont insuffisants (y compris les fusils Gras de 1874) sont 4,30 millions pour 5 millions de soldats, etc.
500 000 hommes sont renvoyés dans leurs foyers, indispensables à l'industrie de guerre. Certains mobilisés n'ont aucune instruction militaire. Pourtant le 10 septembre, le dispositif défensif est en place.
L'État-major dispose de 2 776 000 hommes au front, dont 30 000 officiers d’active et 45 000 officiers de réserve. 2 224 000 hommes sont installés à l'intérieur. Chaque division d'active engendre 3 nouvelles divisions. Une d’active avec les hommes effectuant leur service, une division A comprenant des réservistes, une division B comprenant des réservistes plus âgés, n'ayant effectué qu'un an de service où seul le chef de corps est un officier d‘active. La formation des réservistes est notoirement insuffisante. L'armée de terre peut néanmoins aligner 108 divisions dont 65 d'active, 13 divisions de forteresse et 2 divisions motorisées. Les divisions que la France peut mettre en ligne sur le front du nord-est sont donc de valeur inégale. Cette inégalité de valeur va se révéler désastreuse.
Les gouvernants encore auréolés de la victoire de 1918 n'ont pas écouté les conseils de quelques officiers supérieurs qui insistaient pour moderniser l'armée et demandaient la fabrication d'armes nouvelles ou une meilleure répartition des moyens (exemple avec les généraux Estienne et Georges et le colonel de Gaulle pour les blindés ). Les généraux supérieurs tous pétris de la doctrine officielle (la défense à tout prix) supportent mal ces trublions que sont ces nouveaux officiers préconisant la guerre de mouvement. C'est le général Gamelin qui commande l'Armée de Terre depuis son Quartier Général mais n'a aucune autorité sur l'Armée navale (amiral Darlan) et l'Armée aérienne (général Vuillemin). Les rapports entre ces trois officiers généraux ne sont pas les meilleurs qui soient.
Dès 1929, la France s'est réfugiée derrière une muraille fortifiée, la ligne Maginot, capable d' empêcher le passage de toute armée ennemie et y a massé ses meilleures troupes. Les lignes de fortifications couvrent toute la frontière nord-est depuis la Suisse jusqu'aux Ardennes et de la Suisse à la Méditerranée. Pour préserver les susceptibilités belges, cette ligne n'a pas été entièrement construite jusqu’à la Mer du Nord et puis les troupes allemandes ne pourront jamais traverser les Ardennes. Si jamais cela arrivait, « on » les attend à la sortie de la forêt. Cette fausse sécurité va être fatale.

Intérieur
d'un ouvrage de la ligne Maginot
Mais au delà de la mobilisation des hommes pour les transformer en soldats, c'est la mobilisation générale de toutes les forces vives du pays. La durée de la semaine de travail dans les usines vitales passe à 75 heures par semaine. Les retraités de fraîche date reprennent le travail. Les femmes entrent à l'usine. Les voitures, camions, autocars sont réquisitionnés. Les chalutiers, cargos et paquebots sont réquisitionnés. Des mesures postales sont prises pour le courrier des soldats comme le recrutement de jeunes par l'administration des PTT. Les transports sont réorganisés pour acheminer vers les troupes les vivres, les munitions, les équipements ( une division mange 65 bovins par jour). Une suspension des poursuites judiciaires pour les petits délinquants mobilisés est votée. Le recrutement des étrangers vivants en France est accéléré.


