La ligne Maginot.
Les troupes enfermées dans les forts de la ligne Maginot résistent aux attaques de l'artillerie, des blindés et des stukas, subissant assauts sur assauts de l'infanterie allemande, dès le 14 juin. Les hommes coupés de toutes informations des autres fronts comprennent que la situation doit être grave car ils sont encerclés. Cependant aucun fort important ne sera pris totalement. Il faudra que la commission d'armistice passe d’ouvrage en ouvrage pour signifier aux défenseurs que la guerre est perdue et qu'il faut se rendre. Le 30 juin, 4 jours après l'armistice, ces derniers défenseurs déposent les armes sans avoir été vaincus et prennent à leur tour le chemin des camps de prisonniers. A plusieurs milliers d'entre eux, il avait été promis de les libérer très rapidement. Mensonge ! Des Mosellans et des Alsaciens seront effectivement libérés de leurs camps de prisonniers sur promesse de ne jamais contrarier la machine de guerre allemande. Ils seront incorporés dans les "Malgré nous" en 1942.
Seulement cinq petits ouvrages construits face à la Belgique ont été pris par les Allemands : Eth tenu par le 54e Régiment d'infanterie de forteresse le 26 mai, Les Sarts 23 mai, Bersillies le 22 mai, La Salmagne le 22 mai, Boussois le 22 mai, ces ouvrages tenus par le 87e Régiment de forteresse.
Quatre ouvrages plus importants ont été conquis par l'infanterie allemande après le désormais célèbre message de Pétain. Kerfent défendu par le 156e de forteresse est tombé le 21 juin, Bambesch défendu aussi par le 156e de forteresse est tombé le 20 juin, le Haut Poirier défendu par le 133e de forteresse est tombé le 21 juin, Welschoff défendu par le 166e de forteresse est tombé le 24 juin.
Un seul gros ouvrage a été conquis par les Allemands, celui de La Ferté défendu par le 155e Régiment d'infanterie de forteresse. Attaqué le 18 mai 1940, l'ouvrage de la Ferté, après avoir été bombardé par l'artillerie, a vu sa tourelle et ses cloches démolies par des charges explosives, posées par les sapeurs allemands. Sur ordre du commandement, et ce malgré l'étendue des dégâts (systèmes de ventilation hors service, armes démolies) le lieutenant Bourguignon, commandant l'ouvrage, reçoit l'ordre de ne pas évacuer. Ensuite, les communications avec l'extérieur cessent. Ce n'est que le 2 juin que deux officiers et huit hommes du 191.infanterierégiment entrent dans le bloc 2 et descendent l'escalier. Dans la galerie, ils découvrent les 107 hommes de la garnison, morts asphyxiés.

![]()
Mais partout, des milliers de personnes, civils et militaires fuient sur les routes devant l'avance allemande. De nombreux élus de grandes villes prennent la fuite, abandonnant leurs administrés. Le gouvernement a donné l'exemple en partant vers Tours puis Bordeaux. Des petits fonctionnaires, pour la plupart, font leur devoir jusqu'au bout, ne quittant leur poste que sur ordre de leurs supérieurs. D'autres ont brulés les archives et sont sur les routes à la demande des Autorités. Dans quelques communes, lorsque les Allemands arriveront, il désigneront d'office des administrateurs, les élus sont partis. Des demoiselles des postes seront un modèle de dévouement, continuant jusqu’à la dernière minute à tenir les standards téléphoniques et permettre ainsi les communications de l’ armée. Pratiquement toutes les communications de l’ armée passent alors par le téléphone public. Ce sont, le plus souvent, elles qui indiquent au commandement que l'ennemi est là, qu'il vient d'occuper le standard. D'autres feront leur devoir mieux que beaucoup de militaires, comme ces mécaniciens de locomotives, mobilisés sur place, qui continueront à conduire les trains de soldats sous les attaques des stukas et comme ces douaniers organisés en bataillons de marche qui font le coup de feu au coté des soldats.
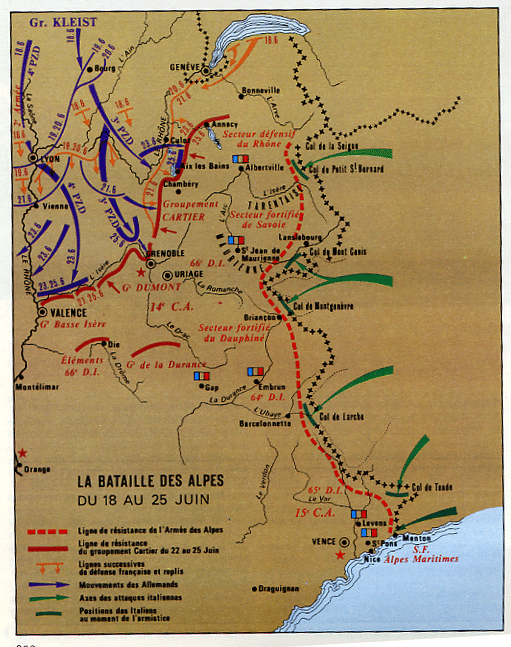
Le front des Alpes, pour afficher en grand la carte passer la souris dessus
A la mobilisation, tout de suite est envisagée une action contre les troupes italiennes sur le Mont Cenis. La guerre n'étant pas déclarée avec l'Italie, l'offensive est reportée puis annulée. Des troupes alpines sont retirées du front des Alpes et dirigées sur la ligne Maginot. La 5e demi-brigade (27e B.C.I., 7e B.C.I., 13e B.C.I.) quitte ses montagnes pour la V° Armée entre Bitche et Wissembourg. Nous avons vu qu'elle sera ensuite dirigée sur la Norvège.
A la déclaration de guerre italienne, le 10 juin, le gl Henry Olry qui commande la VI° Armée a déjà vu partir de nombreuses unités jetées dans la tourmente du front du nord. Il ne dispose plus que de 85 000 hommes à opposer à 550 000 Italiens des I°, IV° et VII° armées italiennes. Les trois divisions alpines françaises : 64e (gl de Saint Vincent), 65e (gl de Saint Julien), et 66e (gl Boucher ) sont composées de soldats d'active ou de réserve pour qui la montagne est une alliée dont ils vont se servir. Chasseurs alpins, bataillons alpins de forteresse, éclaireurs skieurs, chasseurs des Pyrénées sont des soldats solides bien répartis dans un réseau d'outrages fortifiés formant une ligne de défense bien pensée. 299e R.I.A., 47e D.B.C.A., 93e R.A.M., 293e R.A.L.D., 55e G.R.D.I., 64/1e Cie de Sapeurs mineurs, 64/2e Cie de sapeurs mineurs, S. Sect. de Queyras, S. Sect. d'Ubaye, 3e D.B.I. Légère, 2/114 R.A., 64e Parc d'artillerie divisionnaire, 64/81e Cie télégraphique, 64/82e Cie radio, 64/14e Gpe d'exploitation divisionnaire, 64e Gpe sanitaire divisionnaire, 203e R.I.A., 42e D.B.C.A., 46e D.B.C.A., 96e R.A.M., 296e R.A.L.D., 54e G.R.D.I.,,65/1e Cie de Sapeurs mineurs, 65/2e Cie de sapeurs mineurs, S. Sect. de Mounier,,S. Sect. de Tinee,,46e D.B.,96e R.A.M.,,296e R.A.L., 65e Parc d'artillerie divisionnaire, 65/81e Cie télégraphique, 65/82e Cie radio, 65/15e Gpe d'exploitation divisionnaire, 65e Gpe sanitaire divisionnaire, 215e R.I., 281e.R.I., 343e et 9e R.A.D., 209e R.A.L.D., 53e G.R.D.I., 66/1e Cie de Sapeurs mineurs, 66/2e Cie de sapeurs mineurs, 30e Db de Fort, 64e R.A.P., 3/440e R.P., 214/2e Cie de génie,1 et 3/114 R.A.L., 141/54, 173/17, 174/17 et 176/18 Cies muletières, 66e Parc d'artillerie divisionnaire, 66/81e Cie télégraphique, 66/82e Cie radio, 66/16e Gpe d'exploitation divisionnaire, 66e Gpe sanitaire divisionnaire. Dans les airs, la supériorité italienne est totale. Le moral est très élevé.
Les Italiens attaquent le 20 juin, entre le Petit Saint Bernard et la mer. Tous les ponts, toutes les routes qui viennent d'Italie sont coupés. Malgré leurs effectifs, les Italiens sont partout repoussés. En plusieurs endroits, ils ne peuvent même pas franchir la frontière. Dans le Queyras, il fait un froid glacial inhabituel pour juin avec tempête de neige et pluie. Le 87e B.C.A. repousse l'attaque de 12 500 Italiens qui perdent 335 prisonniers devant l'ouvrage de Viraysse. Au col de la Seigne, une section d'éclaireurs skieurs (lt de Castex) subit l'assaut d'un bataillon entier, ils vont tenir plusieurs jours. A la tête de Bellaval, la section du lt Bulle, met en batterie un F.M. et de là dirige toute l'artillerie française. Bulle ira même plus loin en attaquant les Italiens qui refluent en désordre. Le 24 juin, il tient toujours le col. En Maurienne, une attaque italienne contre la pas du Roc et d'Arrondaz est brisée par l'artillerie.
Le 22 les Italiens attaquent avec deux divisions entre le Grammond et la mer. Ils sont rejetés. Le 23, ils attaquent Menton, prennent le cap Martin pour être refoulés. Dans les Alpes-Maritimes, le XV° corps résiste jusqu'à l'armistice face à 10 divisions italiennes appuyées par une artillerie puissante.

Lorsque les Allemands menacent les arrières de l'Armée des Alpes, Olry ne dégarni pas un seul des postes des Alpes et lance un appel à la mobilisation régionale. Arrivent pour contrer les Allemands : des soldats venant de Marseille, des marins du dépôt des équipages de Toulon, 1 250 hommes des compagnies de l'air, 14 compagnies de Génie, 1 compagnie de chars, 1 régiment d'artillerie, 3 groupes de reconnaissance. En tout 30 000 hommes sous le commandement du gl Cartier.
Dans le nord-ouest de la chaîne, la 3.panzer et le 13.infanteriedivision (motorisée) foncent vers Chambéry pour y rejoindre les Italiens. L'ennemi est bloqué par les défenseurs du massif de la Grande Chartreuse, quand aux Italiens, ils sont bien loin ! La 1ère brigade de spahis combat à cheval et repousse les Allemands. L'attaque sur Grenoble est elle aussi contenue. Trois attaques de panzers sont repoussés notamment par les Fusiliers-marins.
Les Allemands sont partout bloqués. Chambéry et Grenoble sont préservées. C'est une Armée des Alpes qui doit se rendre à partir du 23 juin sans qu'elle ait été vaincue. Certains ouvrages ne déposeront les armes que le 1er juillet sur ordres.
![]()
18 juin 1940
Le Général de Gaulle de Londres adresse aux Français un appel qui deviendra célèbre. Qui l'entend ? Un quart de la population française est sur les routes privé de toute information. Une partie est terrée chez elle sans électricité. Quand aux soldats ! Sur tous les fronts, c'est l'effondrement. Pratiquement tous ceux qui raconteront cet appel entendu à la radio, ne l'ont pas entendu. Il ne sera connu de la majorité des Français qu'en 1942. La B.B.C. n'en a pas effectué l'enregistrement. D'ailleurs de Gaulle est un inconnu. Pétain voilà le véritable sauveur.
21 juin
La Lorraine effectue un bombardement de la cote libyenne alors que l'aéronavale bombarde Livourne et Trapani. Le 22 juin, les opérations de la Marine française s'arrêtent.
22 juin
Les délégués français se présentent à Rethondes. Dans la célèbre clairière, le wagon de Foch est au centre, sur un coté le monument à la gloire des armées françaises (voilée), de l'autre la statue de Foch. La délégation française est conduite par le général Charles Huntziger, commandant la IIe Armée de Sedan, suivi d'un civil, Léon Noël, ancien ambassadeur en Pologne, du général Parisot pour l'armée de terre, du Vice-Amiral Leluc pour la Marine, et du Général de l'Air Bergeret pour l'armée de l'air. Hitler est là entouré du maréchal Hermann Goering, du ministre des Affaires étrangères Joachim von Ribbentrop, du maréchal Wilhelm Keitel, le général von Brauchitsch et du général Alfred Jodln de Rudolf Hess, sous la protection des S.S.en uniforme noir de la garde du Fûhrer. Lecture est faite par Keitel des conditions d'armistice. Après de vaines protestations françaises, l'armistice est signé dans le wagon même où le 11 novembre 1918 avait été consommée la défaite allemande.
Le wagon sur ordre de Hitler sera ensuite transféré à Berlin où il sera détruit lors d'un bombardement. Le monument sera détruit sur place. Personne ne touchera à la statue de Foch.
24 juin
Les Allemands sont à Angoulême, Saint Etienne, Bayonne. Ils sont au contact des frontières suisses et espagnoles. On les surnommera : les “Boches”, “Fritz”, “Frises”, "Fridolins”, “Chleus”, “Verts de gris” et “doryphores”' mais il faudra accepter leur présence. Les Italiens entrent à Menton.
24 juin
Armistice franco-italien. Les Italiens peuvent alors occuper la zone qu'ils convoitaient depuis des mois. Hitler ne s'est pas privé de limiter les espérances de Mussolini compte tenu de l'échec de l'intervention italienne. C'est une nouvelle fois, le général Huntziger qui signe pour la France.
Le 25 juin 1940 à 01H35 heure allemande, 00H35 heure française : les combats doivent cesser partout. En fait, dès 21H00, le gouvernement français réfugié à Bordeaux a demandé aux troupes de cesser le combat.
Le 27 juin, le gl Huntziger et une délégation partent pour Wiesbaden où va siéger la commission d'armistice chargée de l'éxécution des accords. Au cours des 6 prochains mois où va siéger la commission, jamais une seule poignée de mains ne sera échangée malgré des réunions quotidiennes. C'est Pétain qui s'en chargera à Montoire.
Dans le pays c'est un immense soulagement. La guerre est terminée, les prisonniers vont rentrer. Et puis, il n'y a pas eu trop de morts (le chiffre est encore inconnu). Pétain est le sauveur de la patrie. La vie va reprendre comme avant. Avant quoi ? Et puis ces Allemands, ils sont très corrects. Ils paient leurs achats, pas comme ces pillards de l'Armée française. L'illusion va durer quelques mois.
![]()
Nous allons retrouver ces soldats de 1940 qui ont échappé à la capture. Officiers, sous-officiers, soldats d’active et de réserve vont encadrer les maquis, constituer les mouvements de résistance et contribuer grandement à la victoire de 1945.
Pour une armée qui ne s'est pas battue, 123 000 morts (2 000 morts par jour), 250 000 blessés, c'est beaucoup, 1 800 000 prisonniers (dont de 37 000 à 40 000 mourront en captivité). Tel est le bilan terrible de cette première partie de la guerre. N'oublions pas que ce bilan des pertes est proportionnellement égal à celui de la bataille de Verdun dans l'autre guerre.

Il faut réhabiliter cette armée de 1940 tant décriée par les vainqueurs de 1945. Nous l'avons vu, tous ne s'enfuient pas. Des hommes en dépit des ordres de repli, tentent de sauver leur matériel, tirant à bras les canons. D'autres unités qui s'enfuyaient, décident tout à coup de faire demi-tour, s'installent au bord d'une route et font face à l'ennemi. D'autres ne doivent se rendre que sur la demande des groupes de civils dans lesquels ils sont englués, pour sauver des vies. Certaines doivent se rendre parce que les rares autorités encore en place les supplient d'épargner les villes et villages qu'ils souhaiteraient défendre.
Bien des soldats de 1940 sont morts en défendant un village, un carrefour, un chemin, une rivière ou un bois. Un monument, aujourd'hui oublié, sera le seul vestige de leur sacrifice. Fantassins, cavaliers, artilleurs s'enferment dans les villages et les bois retardant l'échéance. Les Allemands détachent quelques éléments avec des mitrailleuses pour réduire ses “hérissons”. Ceux-ci succombent après 1, 2 ou 3 jours de résistance, non sans avoir infligé de sévères pertes à l'ennemi qui perd 45 000 morts dans la campagne.
Le courage des régiments régionaux ou territoriaux est un modèle. Il leur est pourtant facile de s'évanouir en cours de nuit, de rejoindre leur logis à quelques dizaines de kilomètres. Qui viendrait les chercher, certainement pas les gendarmes qui font le coup de feu comme les autres. Ces anciens de 1914 vont combattre en première ligne jusqu’à la dernière seconde, ne se repliant que faute de munitions. Le 31e Régiment Régional destiné à garder les ponts et les voies ferrées de Haute-Normandie combat ainsi jusqu'aux portes de Cherbourg. Le 6e Bataillon du 20e Régiment d'infanterie formé de réservistes de 40 ans, dont la moitié des officiers sont des anciens de 1914, va combattre jusqu'au bout du courage. Il forme avec un bataillon de Sénégalais et 250 marins sauvés de Dunkerque, un point d'appui dans le Cotentin, pour permettre l'embarquement des 30 600 Britanniques coincés à Cherbourg. Ils tiennent plusieurs jours, à rendre furieux Rommel qui veut arriver à Cherbourg le plus vite possible.
Le courage des aviateurs n'en est pas moins exemplaire. Surclassés bien souvent par les performances des appareils de l'ennemi, les pilotes français obtiendront tout de même 72 victoires entre septembre 1939 et avril 1940. Le 10 mai, ils sont les premiers à attaquer les colonnes allemandes et obtiennent 49 victoires en une seule journée. Du 13 au 15 mai, 143 appareils allemands sont abattus. Le 22 mai, en cinq minutes 11 stukas flambent alors qu'aucun appareil français n'est abattu. A partir du 15 juin, il faut combattre également contre l'Italie. En moins d'une heure Pierre Le Gloan abat 5 appareils italiens.
Le 25 juin, le Quartier Général de l'Armée de l'air est dissous. L'honneur de l'aviation ne saurait être mis en cause. Depuis septembre, 1 009 avions ennemis ont été abattus. Sur les 800 pilotes français engagés, 194 ont trouvé la mort, 188 sont blessés, 38 ont été fait prisonniers. Les Français vont devoir rendre plus de 700 pilotes de la Luftwaffe qui sont prisonniers. Et pourtant tous les fantassins de l'Armée française auront eu le sentiment que dans le ciel, il n'y avait que des Allemands. Les aviateurs français n'atteindront jamais la notoriété de leurs aînés de 1914-1918.
La démobilisation va commencer dans un enthousiasme général. La Marine est désarmée dans tous les ports français. Les navires ne conservent plus que des équipages réduits.
![]()
Qui se soucie du sort des centaines de soldats noirs, arabes, kabyles et malgaches et de leur encadrement européen, prisonniers de guerre, massacrés au coin d'un bois ? Sur les 177 000 tirailleurs, Algériens, Marocains, Tunisiens, Sénégalais et Malgaches engagés en 1939, il manque 28 000 hommes. Ce ne sont pas les familles qui demanderont des comptes. Car contrairement à ce qu'elles prétendent, les troupes de la Werhmatch, se sont illustrées par des exactions, voulues ou acceptées par le commandement allemand. Compte tenu de la discipline qui règne dans l'Armée allemande, il est difficile d'imaginer que le commandement n'était pas au courant.
Le 5 juin 1940, à Airaines, le 1er bataillon du 53e Régiment d'infanterie Coloniale Mixte Sénégalais composé de Tirailleurs sénégalais et d'appelés du sud-ouest résiste pendant 3 jours à un assaut mené par de l'infanterie et les chars de la 7.panzer de Rommel. A bout de vivres et de munitions, les hommes de la 5e compagnie, qui ont protégé la retraite des autres compagnies, se rendent. L'abomination va commencer, le capitaine N’Tchoréré, un des rares officiers noirs (du Gabon) de l'Armée française est fusillé sur le champ. « Un sous-homme ne peut pas être officier" . C'est aussi le sort du capitaine Bebel (Guadeloupéen) au 24ème Tirailleurs sénégalais. Les rares officiers français qui tentent de s'interposer sont menacés. Quelques uns vont partager le sort de leurs soldats, ils sont également fusillés sur le champ. En maints endroits, les Allemands vont démontrer leur cruauté. D'autres exemples : à Montluçon le 19 juin 1940, 2 jours après la demande d'armistice, des hommes du 25e Régiment de Tirailleurs Sénégalais sont fusillés à la mitrailleuse, mains attachées dans le dos avec du fil barbelé, ceux qui tentent de fuir sont abattus à la mitrailleuse puis pendus par les pieds aux arbres ou écrasés sous les chenilles des chars. Avoir osé résister à l'armée allemande, eux des nègres ! Les exemples ne vont pas manquer de ces exactions comme avec les 16e et le 24e à Aubigny, avec le 12e à Bruillon, avec le 26e à Feucherolles, tous des Régiments de Tirailleurs Sénégalais. Après la guerre, la population allemande mettra des années avant de reconnaître que ses soldats de la Werhmatch (et non pas des S.S. ou des Waffen S.S.) auront commis ces crimes de guerre.

2 juillet : Installation du gouvernement français à Vichy.
La France est occupée, partagée en plusieurs zones d'occupation. Un gouvernement dirigé par Pétain (lequel le vainqueur de Verdun ou celui qui a réprimé les mutineries de 1917 ? ) maintenant un vieillard s'installe dans la partie sud , à Vichy. Zone séparée du reste de la France par une véritable frontière intérieure : la Ligne de Démarcation (Demarkation Linie). C’est le début de 4 années noires.


