Les prisonniers.
Les prisonniers belges, hollandais, anglais, français, sont si nombreux, que les Allemands vont libérer 275 000 Français, dès les premiers jours, faute de troupes pour les garder. Sont ainsi libérés : malades, blessés, fonctionnaires, agriculteurs et anciens combattants de 1914-1918. Ces anciens de 1914 pour qui les officiers de la Werhmatch ont le plus grand respect.
Suivant les accords d'Armistice : après avoir été dirigés vers les Frontstalags en France occupée, 1 600 000 prisonniers prennent le chemin de l'Allemagne et de la Pologne de l'été 1940 à mars 1941 (dont 450 000 cultivateurs ou ouvriers agricoles). Les prisonniers non métropolitains restent en France occupée. Vers la fin de la guerre, ils seront gardés par des gendarmes français.
Les prisonniers continuent de dépendre des forces armées, on va créer pour eux un service diplomatique des prisonniers de guerre qui tente d'adoucir leur sort et de négocier leur retour (avec rang de diplomate : Georges Scapini, aveugle de la guerre 1914-1918). Par contingents très irréguliers, des rapatriements vont s'effectuer. Ces libérations font l'objet d'un chantage continuel de la part des nazis qui détiennent là un puissant moyen de pression.
Au début de l'année 1941, des accords interviennent entre l'État Français et les autorités d'occupation pour permettre la libération d'une partie des prisonniers de guerre français en Allemagne. Il s'agit des pères de famille de quatre enfants mineurs, des frères aînés de quatre enfants, de certaines catégories de fonctionnaires, d'agriculteurs et d'artisans (menuisiers, charpentiers, cimentiers, ferrailleurs) nécessaires au redémarrage de l'économie. Bien que de retour dans leur famille, ces hommes en « Congé de captivité » gardent le statut de prisonniers de guerre et doivent régulièrement venir se faire enregistrer auprès de la Kommandantur la plus proche.
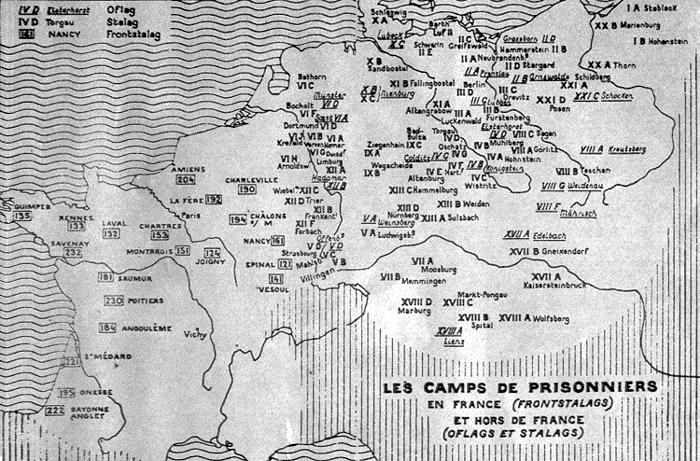
pour voir la carte en grand passer la souris sur l image
|
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre « La durée du travail journalier des P.G., y compris celle des trajets, ne devra en aucun cas dépasser celle des ouvriers civils.... » Pendant longtemps, dans les usines en particulier, cet article ne fut pas respecté et la durée du travail des prisonniers fut bien plus longue que celle des ouvriers civils. Ce n'est qu'après avoir eu connaissance de la convention que les P.G. purent se battre et obtenir le respect de la convention. « Les travaux fournis par les P.G. n'auront aucun rapport direct avec les opérations de guerre....» Un exemple parmi d'autres, l'usine Junkerswerque à Breslau où l’on réparait les avions militaires, pour le plus souvent abîmés aux combats , n'occupait pas moins de 500 P.G. Français et bien d'autres. « Les P.G. évadés qui seraient repris....ne seront passibles que de peines disciplinaires... ». Que dire des 50 Officiers Anglais évadés du camp de Sagan, repris et fusillés. La convention de Genève, d'ailleurs complétée depuis la guerre de 1940/1945, par d'autres conventions, aurait pu être très utile, encore eut-il fallu qu'elle fut connue des combattants, ce qui ne fut jamais le cas pour certains et tardivement pour la très grande majorité des P.G. en kommando. |
La Relève : 2l mars 1942, le Gauleiter Fritz Sauckel - le "négrier" de l'Europe (pendu après le procès de Nuremberg) reçoit d'Hitler les pleins pouvoirs concernant l'utilisation de la main-d'oeuvre dans les territoires occupés. Les répercussions en France sont immédiates, d'autant plus que Pierre Laval, fervent partisan de la collaboration franco-allemande, redevient chef du gouvernement en avril 1942. Après de longues et difficiles négociations, Sauckel et Laval s'entendent pour mettre en oeuvre la Relève dont le principe avait été proposé aux autorités allemandes, dès l'automne 1940, par Georges Scapini, ambassadeur français en charge des prisonniers. Le 22 juin, le Président du Conseil annonce, dans un discours radiophonique tristement célèbre, le contenu de l'accord : en contre-partie du départ de trois ouvriers spécialisés, un prisonnier de guerre rentrera en France. Scapini cette fois n'est pas prévenu et manifeste son mécontentement. (Scapini laissé en liberté surveillée à la Libération, se réfugie en Suisse, est condamné par contumace à 5 ans de travaux forcés, revenu en 1952, il est acquité dans un second procès).
D'ici la fin de l'année 1942, 250 000 travailleurs français devraient rejoindre l'Allemagne dont 150 000 spécialistes. En juin, ils sont 12 000 volontaires, en juillet 23 000 et en août 18 000. A la fin de l'année 1942, ils sont seulement 240 000. La relève n'entraînera donc pas la libération escomptée de tous les prisonniers de guerre prévus. La Relève sans être un échec n'est pas une réussite non plus. Le 11 août 1942, l'arrivée en gare de Compiègne du premier train de prisonniers de retour d'Allemagne est annoncée tambours battants. Mais par la suite, le retour s'effectue au compte-gouttes et l'opinion publique comme les prisonniers eux-mêmes, en viennent rapidement à dénoncer ce marché de dupe. Surtout que l'on s'aperçoit vite que sont libérés les blessés, les malades et les inaptes à l'économie de guerre allemande.
En août 1942, Sauckel menace de recenser tous les hommes et toutes les femmes de 18 à 55 ans de la zone occupée et de déclarer leur mobilisation générale. Le gouvernement de Vichy parvient à biaiser en effectuant lui-même le recensement des hommes de 18 à 50 ans et les femmes célibatires de 21 à 35 ans. C'est le prélude au S.T.O..
Le temps du S.T.O. (Service du travail obligatoire) verra 700 000 Français déportés en Allemagne et en Pologne dans les usines de guerre.
En 1943, 200 000 prisonniers sont transformés en travailleurs libres. Libres surtout de continuer à travailler en Allemagne, ils ne quittent un camp que pour un autre camp. Cette mesure permet de libérer 30 000 gardiens allemands qui rejoignent le front russe.
Les services de propagande nazis se servent des prisonniers, en libérant au coup par coup des groupes d'hommes. Un exemple, avec les prisonniers de la région de Dieppe (1 581 libérés). C'est le remerciement d'Hitler à la population pour sa prétendue collaboration à l'échec du débarquement anglo-canadien du 19 août 1942. En réalité, ces prisonniers ne sont libérés qu'en lieu et place de prisonniers d'autres régions, prévus au titre de la relève. Qu'en à la prétendue collaboration de la population civile avec l'Armée allemande, simple propagande.

Le
retour des “Dieppois”
En 1944, près de 430 000 prisonniers ont ainsi regagné leur foyer.
![]()
Les prisonniers de guerre sont enfermés dans 56 stalags (troupe et sous-officiers) et 14 Offizierlagers ou oflags (officiers), gardés par des soldats de la Werhmacht ou de la Luftwaffe, parfois anciens combattants de 14/18 ou mutilés inaptes pour le front. La vie dans les camps de prisonniers s'organise. Des camps sont transformés en Stammlager (où camp souche) où les prisonniers ne font que passer entre leur travail dans les commandos. Les hommes de troupe sont embauchés dans les 80 000 commandos (Kommandos) de travail à la place des ouvriers allemands mobilisés. Kommandos militaires où les prisonniers éxécutent des travaux sur route ou voie ferrée, mais peu à peu ce sont les prisonniers soviétiques qui vont remplacer les Français, Kommandos d'usine (tout le monde comprend), Kommandos de ville pour les artisans qui vont exercer leur profesion, Kommandos agricoles (les plus nombreux) où ils sont à 58 % employés dans l'agriculture, la pêche ou les forêts. On va retrouver des prisonniers de guerre français dans toutes les branches de l’activité allemande y compris l'industrie de guerre (ce qui est contraire aux Conventions de Genève). Plus tard, ils sont très nombreux a être employés dans le déblaiement des villes bombardées par l'aviation alliée. Beaucoup paient de leur vie cette affectation.
Ils sont sollicités pour s'engager dans la Légion des Volontaires Français contr le Bolchevisme. Le projet ne rencontre aucun succès.
Si nos prisonniers mangent mal, les populations française et allemande ne sont pas mieux loties. Comme tous bons Français, ils arrivent à se débrouiller. Ils peuvent recevoir du courrier de France, certes contrôlé, recevoir des colis par la Croix Rouge (officiellement 2 par mois). Colis qui n'arriveront pas tous. Les prisonniers peuvent écrire à leur famille ( 2 cartes de 7 lignes et 2 lettres de 26 lignes maximum écrites au crayon par mois). Ils sont protégés par les Conventions de Genève qui traitent des lois de la guerre. Remarquons que les Allemands ont des prisonniers en Angleterre, aux États-Unis ou au Canada qu'il convient de préserver de représailles et le sort des Britanniques et Américains prisonniers en tiendra compte.
Tout est tenté pour occuper les prisonniers en dehors des périodes de travail. De nombreuses activités se développent, tournoi sportif, théâtre, cinéma, jardinage. Un journal est créé "Trait d'union" qui rédigé par des prisonniers est distribué dans les camps. Bien entendu, toutes les activités sont soumises au diktat des chefs de camp. Si bien que les prisonniers ne sont pas tous traités de la même façon. La personnalité des chefs de camp aura beaucoup compté dans la rigueur du traitement des prisonniers.
Ces prisonniers alliés prennent de plus en plus de place dans l'économie allemande et dans la gestion du quotidien. A la fin de la guerre, on en verra même gérer des pans entiers de l'économie allemande et diriger des villages, lorsque tous les Allemands valides de 12 à 75 ans seront partis au front. Quelques isolés ne reviendront jamais chez eux, préférant rester en Allemagne. Ils seront peu à tenter de s'évader, peut-être 100 000 en comptant ceux qui s'échappent entre l'arrestation et le transfert en Allemagne. .
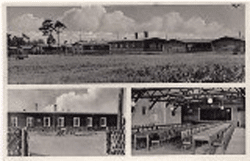
Stalag
VIII C en Pologne collection
personnelle
![]()
Il ne faut pas confondre ces camps de prisonniers de guerre avec les camps de concentration (Konzentrationlager), dont le but est le travail forcé jusqu’à épuisement des hommes, des femmes et des enfants, puis leur élimination. Et surtout pas avec les camps d'extermination (Vernichtungslager) dont le but est l'extermination totale du peuple juif, des tziganes, des handicapés, des opposants au régime nazi. Tous ces camps gérés par l'administration de la S.S.(Wirtschafsverwaltungshauptant).
Cependant, les conditions de vie dans les camps de représailles de prisonniers situés entre-autres à Rawa-Ruska et ses sous-camps (aujourd'hui en Ukraine) s'apparentent aux camps de concentration. Ces camps administrés par les S.S. appliquaient les mêmes règles que les camps de concentration et étaient destinés aux récidivistes de l'évasion, aux "fortes têtes". Ces camps seront libérés par les troupes soviétiques et les survivants ne reviendront qu'en 1945.
![]()
Lorsque le prisonnier libéré à la chance de revenir avant 1945, il doit se remettre au travail rapidement. Paradoxe, il se met directement ou indirectement au service de l'occupant, dans les immenses chantiers qui jalonnent les cotes de la Manche, de l'atlantique et la Méditerranée, dans les usines qui produisent beaucoup plus pour les Allemands que pour les Français, dans le travail de la terre dont les produits sont expédiés en Allemagne.


