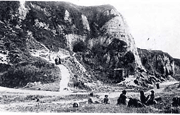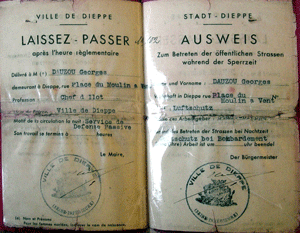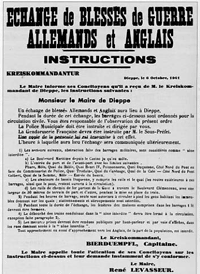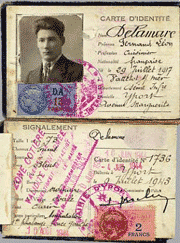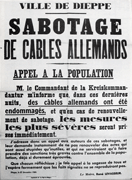|
Ce qui n'était encore
qu'un espoir en l'homme providentiel qu'est le maréchal
Pétain, a tourné à l'idolâtrie pour
une partie de la population, un véritable culte de la
personnalité. Tous les textes commencent ainsi : "Nous,
Philippe Pétain, Maréchal de France, chef de l'État
français, le Conseil des ministres entendu, décrétons
..." (un relent de monarchie). Les fonctionnaires et militaires
prêtent serment de soumission au maréchal. Un hymne,
que tous les enfants apprennent à l'école est écrit
à sa gloire. Les Français se découvrent
40 millions de maréchalistes. Les Normands comme les autres.
Il faut bien croire en quelque chose. Le portrait de Pétain
en 28x36 est en vente au prix de 5 francs. Pendant des années,
les Français vont croire également au double jeu
du Maréchal entre les Alliés et les Allemands (le
débat est encore ouvert) et lui manifesteront leur confiance.
Dans les mairies, le buste de Marianne est remplacé par
celui du Maréchal. Il faudra quelques rappels à
l'ordre car des maires sont encore réticents. La République
est abolie et l'État Français prend pour devise
: Travail, Famille, Patrie, prônant la Révolution
Nationale. La francisque se substitue à l'effigie de la
République. Les timbres poste sont à l'effigie
de Pétain, des pièces de monnaie sont frappées
avec la francisque. Chaque commune va dénommer une voie
du nom du Maréchal Pétain. A Dieppe, c'est le boulevard
Bérigny qui est baptisé dès janvier 1941.
La presse suit pas à pas les déplacements du Maréchal
et le moindre de ses propos est relaté (1/2 page le 16
août). Cette idolâtrie ne durera pas et de plus en
plus de Français s'interrogent. Ce début de 1941
marque déjà un recul de popularité. La poignée
de mains Hitler-Pétain à Montoire et les déclarations
de Laval souhaitant la victoire de l'Allemagne feront se détourner
du régime une grande partie de l'opinion (1). D'autant
que dans les faits ce sont les préfets, sous-préfets
et maires qui dirigent chacun leur portion de territoire, en
relation constante avec l'occupant. |
|
|
Les autorités prônent la Révolution
Nationale. Du national, on en met partout. La Loterie Nationale
voisine avec le Secours National et l'Emprunt national. Le café
national (une infâme mixture dont il vaut mieux ignorer
la composition) est sur les rayons aux cotés du chocolat
national. Les chaussures nationales (sans cuir) sont vendues
avec la peinture nationale (sans huile). Les partis politiques
ne sont pas en reste : le Parti Populaire Nationale chante le
cantique national.
Ce qui préoccupe le plus les Français,
ce sont les restrictions qui se font de plus en plus sévères.
La ménagère qui va faire ses courses ne sait jamais
d'avance ce qu'elle va trouver. La femme est réduite à
ce rôle de mère et d'épouse. Les fonctionnaires
féminines ont été poussées à
démissionner. Toutes les femmes doivent faire des enfants.
Entre autres slogans : "Si nous avons perdu la guerre c'est
que depuis 1919, elles n'ont pas eu assez d'enfants". Malgré
le désir de Vichy de voir la femme rester au foyer, beaucoup
sont contraintes de travailler et l'on travaille beaucoup sous
Vichy, de 45 à 54 heures par semaine. 700 000 femmes ont
leur mari prisonnier en Allemagne et beaucoup ont des enfants,
comment vivre ? Il faut attendre juillet 1942, pour qu'une allocation
militaire soit versée aux femmes de prisonniers (20 francs
par jour à Paris, 15 francs ailleurs). Maintenir les femmes
chez elles est une utopie et dès le 3 avril 1941, le gouvernement
abroge une partie des décisions du 11 octobre 1940 renvoyant
la femme à son foyer (la loi de 1940 sera totalement abrogée
en 1942).
|
 
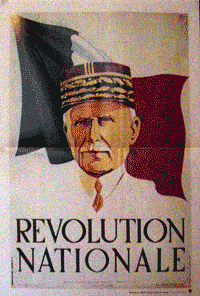
|
|
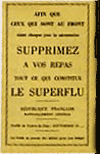
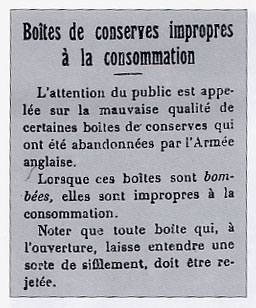
|
Les rations font l'objet de réajustements
continuels. Mais qui peut dire si les quantités prévues
seront disponibles ? Chaque individu, grand ou petit, enfant,
actif ou retraité a été classé dans
une catégorie bien déterminée et chaque
catégorie a droit à une quantité de produits
bien définie. E
enfants de moins de 3 ans, J1 enfants de 3 à 6
ans, J2 enfants
de 6 à 13 ans, J3
adolescents de 13 à 21 ans, A cartes ordinaires,
T travailleurs de force, C travailleurs agricoles.
La liste des professions ouvrant droit à la carte travailleur
de force sera sans cesse revue sous les pressions corporatistes.
Il y a des quantités journalières pour certains
produits et d'autres hebdomadaires ou mensuelles, casse-tête
permanent. Au premier avril 1941, la ration de pain varie de
100 gr à 350 gr par jour suivant les catégories,
la viande : 360 gr avec os ou 288 gr sans os par semaine, les
matières grasses : 400 gr par mois, le savon : 75 gr de
savonnette ou de savon de ménage + un autre savon de ménage
ou 250 gr de poudre à laver ou 1 kg de lessive au savon
par mois, les hommes bénéficient de 1 bâton
de savon à barbe par mois, du moins ceux de plus de 17
ans. La quantité de lait varie avec l'âge des bébés
et également suivant que la mère allaite ou non.
Pour le chocolat, il est nécessaire de se faire inscrire
préalablement sur un registre tenu par un commerçant
(et un seul). Fromage : 70 gr par semaine, sucre de 50 gr à
1 kg par mois, le riz : de 200 à 300 gr, les pâtes
375 gr par mois, les légumes secs : néant. Il y
a des tickets de charbon, de textile, de tabac, de vin, de chaussures,
etc.... La paire de ciseaux devient un outil indispensable pour
le commerçant, car c'est lui qui découpe les vignettes
et pas question de se présenter sans sa carte de rationnement
en cours de validité. Même le poisson est contingenté,
avec une carte spécifique, un comble à Dieppe.
Certains produits contingentés sont seulement disponibles
chez quelques commerçants. Chaque mois, il y a de nouvelles
cartes avec de nouvelles quantité , jusqu' à la
création de cartes de jardinage. Sur ces maigres rations,
les épouses de prisonniers vont encore économiser
pour envoyer à leur mari un colis pour l' Allemagne. Elles
savent désormais, approximativement, où est leur
mari car la presse a diffusé un grand nombre des lieux
d'implantations des oflags (offizierlager), stalags (stammlager)
et frontstalags (camp de transit installé en France). |
|
|
Les troupes d'occupation commencent
à construire ce qui deviendra le mur de l'Atlantique (Westwall).
Des centaines d'habitants sont expulsés de leur maison
pour élargir les champs de tir des canons et armes automatiques.
Parmi eux, les plus pauvres parmi les pauvres qui habitent encore
les gobes (cavités de la falaise). Ce qu'il faut bien
appeler leur domicile est transformé en abri bétonné.
Les plaines côtières sont inondées. Le pillage
des matériaux de construction atteint son maximum, graviers,
sable, barbelés, bois, sont réservés presque
exclusivement à la construction des défenses allemandes.
Une bonne dizaine de firmes allemandes s'installent
qui vont entrer en concurrence avec l'Organisation Todt pour
les embauches de main-d'oeuvre.
|
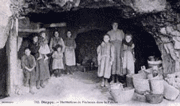 (coll.
Guy Naze) (coll.
Guy Naze)
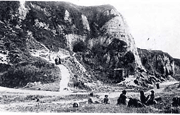
|
|
 |
Le 23 février 1941 parait à
Dieppe un nouveau journal du dimanche, au prix de 1 franc, le
"Courrier de Dieppe" (rédacteur en chef E.Renoux-Bares).
A vocation régionale, ce journal diffuse un peu plus d'informations
sur les communes voisines de Dieppe, surtout les avis officiels.
Dès le début, il se veut plus polémique
et ne se prive pas de dénoncer les lenteurs et les incohérences
du ravitaillement, les inégalités de traitement
entre régions et entre les communes, le manque d'égards
pour les familles des victimes de la guerre. Il dénonce
également la paperasserie qui commence à envahir
la vie quotidienne des Français. Cela durera t-il sachant
que toute la presse est soumise à la censure de l'occupant
? A moins que les Allemands laissent passer ces articles pour
montrer que Vichy ne gouverne rien. Une administration paperassière
: carte d'identité, carte de travail, certificats divers,
certificat de métier, carte d'ancien combattant, livret
militaire, cartes d'alimentation et ses tickets, documents qu'il
faut avoir en permanence sur soi. C'est également le temps
du laissez-passer, il faut un "ausweiss" pour franchir
la ligne de démarcation, il faut une autorisation pour
circuler en zone interdite, il faut une autorisation pour sortir
la nuit
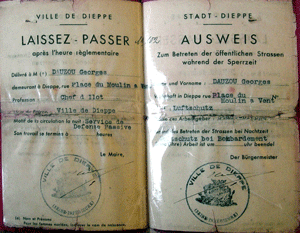  Document Alain Dauzou - tous droits réservés
Document Alain Dauzou - tous droits réservés
|
. |
|
Les bombardements alliés continuent,
les 4 février (place L.Vitet), 6 février (magasins
généraux et Neuville lès Dieppe), 10 mars
(centre ville, Caude-Côte), 14 mars, 16 mai, 17 mai, 18
mai (mairie), 3 juillet (entre Martin Eglise et Dieppe), 26 juillet,
14 août. Chacun de ces bombardements laisse derrière
lui son lot de victimes civiles, de destructions. Le gouvernement
de Vichy à travers la presse et la radio d'état
(Radio-Paris) devenues pro-allemandes ne manquent pas de dénoncer
ces attaques aériennes aveugles. A la suite des bombardements
de mai, la mairie transfère une partie de ses bureaux
(la mairie est alors située sur l'emplacement actuel du
casino, rue de l'Hotel de Ville, aujourd'hui rue du Commandant
Fayolle) et les archives et documents anciens sont également
évacués, partie dans les souterrains du château,
partie au château des Vaux en Eure et Loir.
Une décision va meurtrir un peu plus
les Français sinistrés. Les matériaux de
démolition provenant des ruines sont la propriété
de l'Etat. Les matériaux peuvent être vendus par
l'Administration. Ainsi celui qui vient de voir détruire
sa maison doit en racheter les débris !
|
 17 mai 1941, Rue Salomon de Caus
Document Mme Caltot -tous droits réservés
(2)
17 mai 1941, Rue Salomon de Caus
Document Mme Caltot -tous droits réservés
(2) 
|
|
|
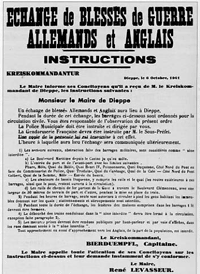
Archives Ville de Dieppe
|
En mars 1941, l'occupant organise en
grande pompe militaire les obsèques du capitaine de frégate
Peters, commandant de la Hoffenkommandantur, mort en service
d'une crise cardiaque. Les autorités civiles de Dieppe
sont là.
Lorsque le préfet de Seine Inférieure
visite Dieppe, il constate que des chantiers de travaux publics
sont ouverts pour employer la main d'oeuvre locale, malgré
le pillage allemand (le plateau sportif route de Pourville notamment),
que l'hôpital et l'hospice ont pu s'installer dans les
souterrains de la Biomarine et l'école Richard Simon après
la main mise des occupants sur l'hôpital général,
qu'une cantine scolaire a pu s'installer à l'angle du
faubourg de la Barre et de l'avenue Gambetta, que la police et
les pompiers sont bien installés (emplacement ancien de
la caserne des pompiers, qui vient de déménager).
Un rappel à l'ordre est diffusé
concernant l'hébergement éventuel d'aviateurs alliés
abattus. Rappel après une première campagne d'affichage
en octobre 1940. Les Français cacheraient des aviateurs
abattus ?
|
|
|
En août, les Allemands interdisent
l'accès de la région aux propriétaires de
résidences secondaires (en réalité certaines
sont déjà occupées par les troupes allemandes
ou ont été détruites). Ceux qui s'y étaient
réfugiés, fuyant les grandes villes, doivent repartir.
20 octobre 1941.
Les communes du bord de mer depuis le Danemark jusqu'à la frontière
espagnole sont classées Zone côtière
interdite - Kuestenzone. Cette zone de profondeur
inégale inclus les îles littorales. Seuls les habitants
ayant leur résidence ordinaire dans ces communes (depuis
au moins 3 mois), les membres des entreprises
civiles travaillant pour les Allemands, le personnel ambulant
de la S.N.C.F. et les troupes d'occupation peuvent circuler dans
la zone ainsi créée (Dieppe est compris dans cette
zone). Aucun échange téléphonique ou télégraphique
ne peut se faire au delà des limites de la zone. Les étrangers
à la zone ne peuvent y pénétrer qu'avec
un laissez-passer spécial très difficile à
obtenir. La carte d'identité est exigible à tout
moment. Les colonies de vacances, les
camps de jeunesse sont interdits dans la zone. A l'entrée
de la zone, des pancartes sont apposées informant les
voyageurs, car identifier les communes de la zone interdite et
celles extérieures n'est pas si évident, la zone
est d'inégale largeur. Dans la région, Envermeu,
chef lieu de canton dans la vallée est hors zone et Saint
Nicolas d'Aliermont sur le plateau est dans la zone interdite.
|
  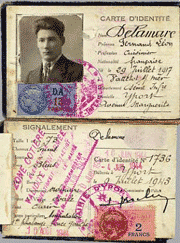

|
|
 |
26 octobre 1941 : nouvelles rémunérations
minimales de travail : 19,10 f de l'heure pour un ouvrier qualifié,
17,40 f pour un ouvrier spécialisé, 15,80 f pour
un aide ouvrier, + des primes éventuelles pour les hommes
mariés + primes de déplacement. Le litre de lait
coûte 2,30 f (lait entier) ou 2,10 f (lait écrémé),
les bananes 14,60 f le kilo, les harengs 13,80 f le kg. Lorsqu'il
y a en a.
1er novembre 1941 : c'est la saison de la
pêche aux harengs. Exceptionnellement des canots de Fécamp
et d'Yport sont autorisés à venir à Dieppe
(ils y venaient du temps de paix depuis des lustres). Moyenne
des prises : 900 kilos par jour pour les 48 canots qui livrent.
Mais la reprise de la pêche entraîne son lot de drames,
le canot Jean-Claude de Fécamp saute sur une mine : 8
morts.
4 Décembre : nouveau bombardement à
Martin-Eglise.
5 décembre 1941 : les pigeons voyageurs
doivent être livrés à la Feldnachrichtenkommandantur.
Encore un organisme au nom imprononçable.
|
|
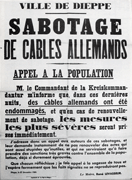 Archives Ville de Dieppe
Archives Ville de Dieppe
|
10 décembre 1941 : à la
suite du sciage d'un câble téléphonique allemand
le Feldkommandant Von Bartenwerffer ordonne que les câbles
soient désormais gardés à tour de rôle
par des Dieppois de 18 à 25 ans réquisitionnés.
Impossible de se dérober sinon une : peine de travaux
forcés ou de prison . Un homme tous les cent mètres
entre 21h et 4h, toutes les nuits. Si la Résistance détruit
ces lignes malgré tout, le "surveillant" est
puni.
La mesure avait déjà été
effective en décembre 1940 pour quelques semaines.
23 décembre 1941 : de nouvelles arrestations
touchent les membres et anciens membres du Parti Communiste.
|
|
vers
1942

 
|
|
(1) Comment
expliquer cependant les foules importantes qui viendront l'acclamer
à tous les voyages en province jusqu'à celui de
Rouen en Mai 1944.
(2) Dans
ce bombardement périrent les frères Bernard (8
ans) et Paul (14 ans) CALTOT . Photo collection personnelle de
Mme Caltot (leur soeur).
|
| |



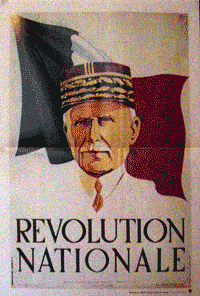
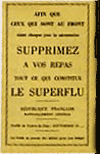
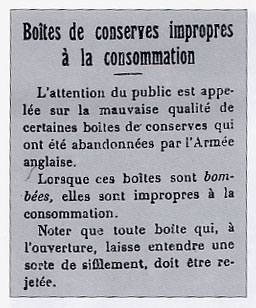
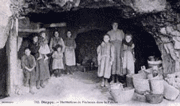 (coll.
Guy Naze)
(coll.
Guy Naze)